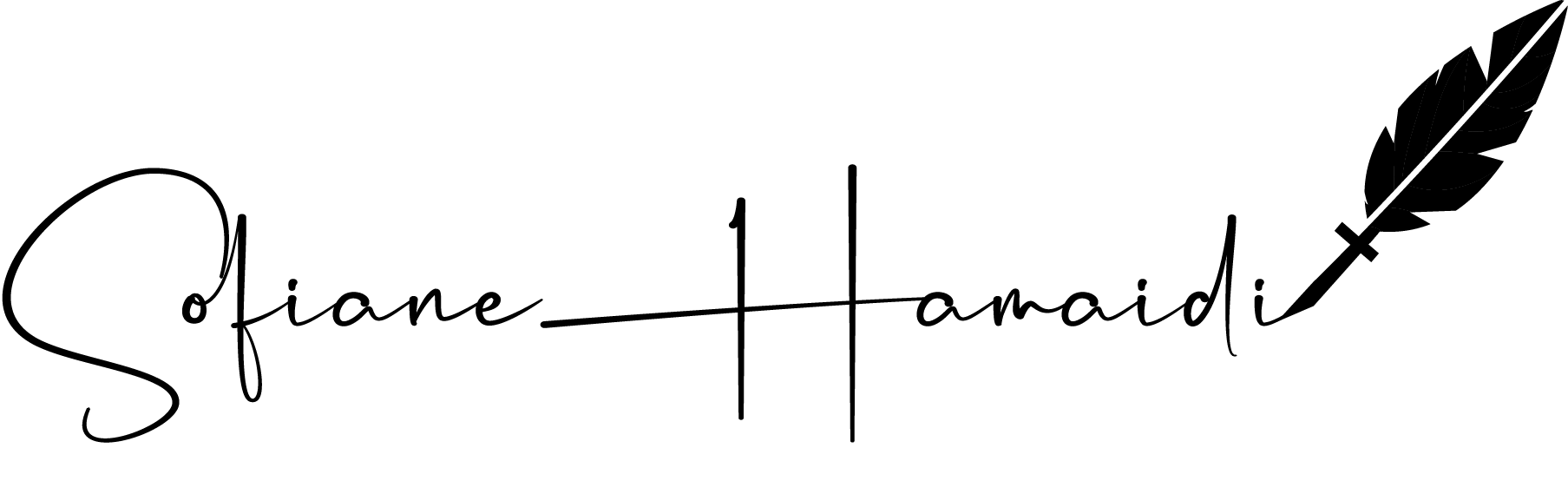En trente ans, la culture du cacao a détruit 90 % de la couverture forestière de Côte d’Ivoire, premier producteur mondial. Derrière nos tablettes de chocolat se cache un système économique qui pousse à l’exploitation extensive des terres plutôt qu’à leur optimisation, transformant les forêts en désert agricole.
La Côte d’Ivoire a perdu 90 % de sa couverture forestière en trente ans. La principale cause : la cacaoculture. Ce pays d’Afrique de l’Ouest concentre à lui seul 44 % de la production mondiale de cacao, selon les données de l’Organisation internationale du cacao (ICCO). À l’autre bout de la chaîne, les États-Unis et l’Europe absorbent trois quarts des récoltes mondiales. Un flux commercial qui transforme méthodiquement les forêts tropicales en plantations, au mépris des engagements internationaux.
Lors de la COP 26 à Glasgow en 2021, 141 pays, dont tous les grands producteurs et consommateurs de cacao, ont signé une déclaration visant à mettre fin à la déforestation d’ici 2030. Deux ans plus tard, le rapport 2023 du Forest Declaration Assessment, publié le 23 octobre par une coalition d’ONG et d’organismes de recherche, dresse un constat sans appel : en 2022, près de 6,6 millions d’hectares de forêts ont disparu dans le monde, dont 4,1 millions dans les régions tropicales. Le rythme de déforestation n’a pas ralenti. Il s’est même accéléré dans certaines zones de production de matières premières agricoles destinées à l’exportation.
Culture extensive contre culture intensive
Le mode de production du cacao explique en grande partie ce désastre écologique. Contrairement à ce que pourrait suggérer une logique de rentabilité, les cacaoculteurs privilégient massivement la culture extensive, de grandes parcelles peu entretenues, plutôt que la culture intensive qui optimiserait les rendements sur des surfaces réduites.
Le rendement moyen du cacao en Côte d’Ivoire s’établit autour de 500 kilogrammes par hectare, selon les données du Conseil café-cacao ivoirien. Dans des conditions optimales, avec un entretien régulier des plants, une gestion raisonnée de l’ombrage, une fertilisation adaptée et un contrôle des maladies, ce rendement pourrait atteindre 2 500 kilogrammes par hectare, soit cinq fois plus sur la même surface.
Pourquoi alors cette sous-exploitation chronique ? La réponse tient en un mot : investissement. Optimiser une plantation de cacao demande du capital, des intrants, du temps et des connaissances techniques. Pour des producteurs vivant dans l’extrême précarité, avec des revenus aléatoires et sans accès au crédit, ces investissements sont hors de portée. Il devient alors économiquement plus rationnel de compenser les faibles rendements par l’extension des surfaces cultivées.
La forêt représente dans cette équation une ressource gratuite et disponible. Défricher quelques hectares de forêt primaire pour y planter des cacaoyers coûte moins cher que d’améliorer la productivité de parcelles existantes. Ce calcul économique absurde, destructeur à long terme mais logique à court terme pour des producteurs acculés, constitue le moteur principal de la déforestation. Chaque année, de nouvelles parcelles sont ouvertes tandis que d’anciennes plantations, épuisées et mal entretenues, sont progressivement abandonnées.
Cette logique extensive détruit méthodiquement le bien commun que constituent les forêts tropicales : régulation du climat, préservation de la biodiversité, maintien du cycle de l’eau, stockage du carbone. Des fonctions écologiques essentielles sacrifiées pour maintenir une production à faible valeur ajoutée.
Un rapport de force déséquilibré
Le système économique mondial du cacao perpétue cette dynamique destructrice. Douze multinationales, majoritairement américaines et européennes, contrôlent l’ensemble de la chaîne de valeur, du broyage des fèves à la distribution des produits finis. Cette concentration extrême du pouvoir de marché leur permet de dicter les termes des échanges commerciaux.
Les chiffres de répartition de la valeur sont éloquents. Sur le prix d’une tablette de chocolat vendue en Europe, seulement 7 % reviennent aux cacaoculteurs, selon les estimations de Fairtrade International. Les 5 millions de petits producteurs, atomisés et désorganisés, ne pèsent rien face à cette oligopole. Ils subissent les prix sans pouvoir négocier.
Le marché mondial du cacao fonctionne sur un système de cotation internationale, fixée à la bourse de Londres et de New York. Mais cette cotation reflète avant tout les équilibres entre grands négociants et industriels, pas les coûts réels de production ni les besoins de revenus des producteurs. Lorsque la demande augmente ou que les récoltes diminuent, les cours peuvent s’envoler, mais ces hausses profitent d’abord aux intermédiaires. À l’inverse, lorsque les prix s’effondrent, ce sont les producteurs qui encaissent directement la perte.
Aucun dispositif efficace de prix minimum garanti n’a été mis en place à l’échelle internationale. Les tentatives de la Côte d’Ivoire et du Ghana, qui représentent ensemble les deux tiers de la production mondiale, d’imposer un différentiel de revenu décent (DRD) de 400 dollars par tonne en 2019 se sont heurtées à la résistance des acheteurs, qui ont pu contourner cette mesure en se tournant vers d’autres origines ou en jouant sur les mécanismes de marché.
Dans ce système, la rémunération des producteurs dépend du bon vouloir des entreprises acheteuses et de programmes de certification volontaires (Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ) qui, malgré leurs efforts, ne concernent qu’une fraction minoritaire de la production et n’ont pas inversé les tendances de fond.
Le piège de la pauvreté
L’extrême précarité dans laquelle vivent la plupart des cacaoculteurs les enferme dans une vision à court terme. Selon la Banque mondiale, environ 40 % des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire vivent sous le seuil de pauvreté international (moins de 2,15 dollars par jour). Dans ces conditions, la préoccupation immédiate, nourrir sa famille, payer la scolarité des enfants, écrase toute considération environnementale à long terme.
Cette pauvreté structurelle explique aussi le recours massif à une main-d’œuvre précaire et souvent exploitée. La culture du cacao, non mécanisée, exige un travail manuel intensif : défrichage, plantation, entretien, récolte, fermentation. Pour compenser des revenus insuffisants, de nombreux producteurs font appel à une main-d’œuvre migrante, parfois dans des conditions proches de l’esclavage moderne.
Des enquêtes menées par l’ONG Mighty Earth et par l’Université de Chicago ont documenté l’emploi d’enfants, y compris des mineurs de moins de 14 ans, dans les plantations, souvent issus de pays voisins comme le Burkina Faso ou le Mali. Ces enfants travaillent dans des conditions dangereuses, manipulant machettes et pesticides, pour des salaires dérisoires ou parfois contre la simple promesse d’être nourris et logés.
Les multinationales du chocolat se disent engagées contre le travail des enfants et financent des programmes de traçabilité. Mais les résultats restent marginaux. Une étude de l’Université de Chicago publiée en 2020 estimait à 1,56 million le nombre d’enfants travaillant dans la cacaoculture en Côte d’Ivoire et au Ghana, un chiffre en augmentation par rapport aux années 2010. Le système économique du cacao exploite simultanément les forêts et les populations les plus vulnérables.
Un problème qui dépasse le cacao
Le cacao n’est qu’un cas parmi d’autres d’un modèle global d’exploitation des régions tropicales au profit de la consommation des pays riches. Le café, le soja, l’huile de palme, le bois tropical suivent des logiques similaires : production extensive sur des terres gagnées sur la forêt, main-d’œuvre précaire, captation de la valeur par les acheteurs finaux, destruction accélérée des écosystèmes.
Le rapport 2023 du Forest Declaration Assessment confirme que ces filières agricoles d’exportation restent les principaux moteurs de déforestation dans le monde. En Amazonie, c’est l’élevage bovin et le soja. En Asie du Sud-Est, l’huile de palme. En Afrique de l’Ouest, le cacao et le bois. Des géographies différentes, mais une mécanique identique : convertir du capital naturel en productions agricoles à bas coûts pour satisfaire une demande internationale.
Les engagements de « zéro déforestation » se multiplient, tant de la part des États que des entreprises. La réglementation européenne sur les produits « zéro déforestation », adoptée en 2023 et qui entrera progressivement en vigueur, interdit l’importation dans l’UE de produits issus de terres déboisées après 2020. Un pas en avant, mais dont l’efficacité dépendra des moyens de contrôle et de traçabilité mis en œuvre.
Inverser la logique
Pour briser le cercle vicieux de la pauvreté des producteurs et de la destruction forestière, plusieurs leviers doivent être actionnés simultanément. D’abord, garantir un revenu décent aux cacaoculteurs, ce qui suppose soit des prix d’achat plus élevés, soit une répartition différente de la valeur le long de la chaîne. Ensuite, financer massivement la transition vers une cacaoculture intensive et durable, avec formation technique et accès au crédit. Enfin, sanctionner réellement les entreprises qui continuent de s’approvisionner sur des zones de déforestation récente.
Quelques expériences montrent qu’une autre voie est possible. En Équateur, des programmes d’agroforesterie associent cacaoyers et arbres forestiers, maintenant une couverture végétale tout en produisant du cacao. Au Pérou, des coopératives de petits producteurs ont réussi à améliorer leurs rendements et leurs revenus grâce à l’agriculture biologique et au commerce équitable. Mais ces initiatives restent marginales face à l’immensité du défi.
Tant que le modèle économique dominant récompensera l’extension des surfaces plutôt que l’amélioration des rendements, tant que les forêts resteront la variable d’ajustement d’un système commercial déséquilibré, les engagements de 2030 resteront lettre morte. Et nos tablettes de chocolat continueront de porter en elles le goût amer de la déforestation.