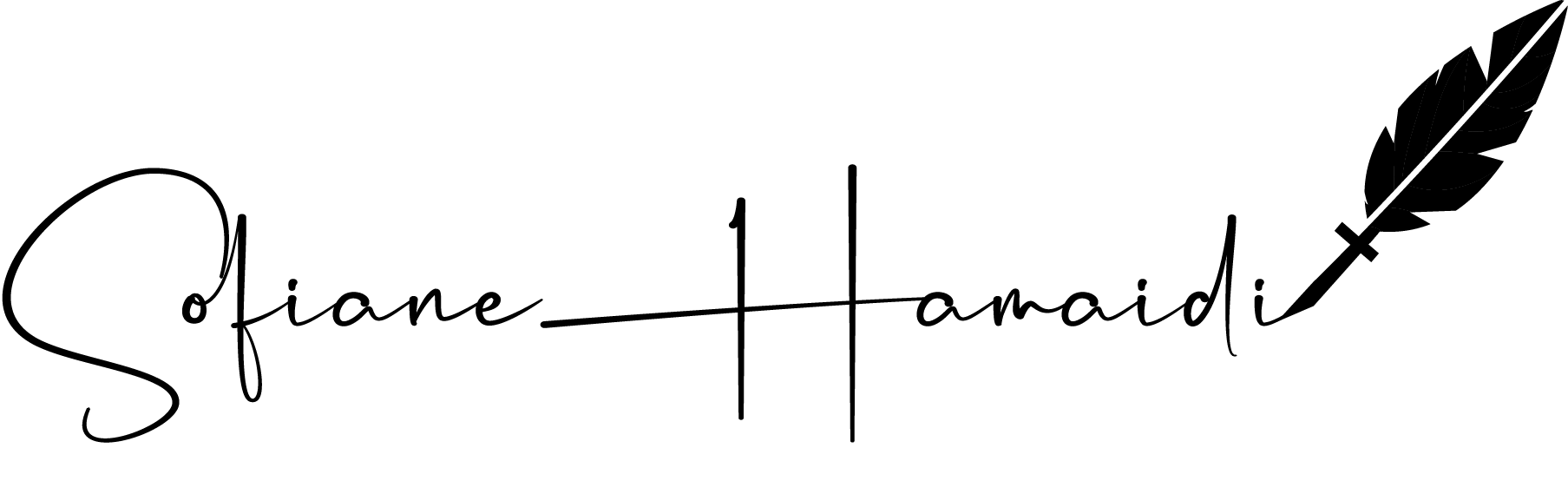À deux pas du tapageur boulevard Raspail, la rue Vavin baisse la voix à l’approche de minuit. Les terrasses se vident, les rideaux tombent, les livreurs repartent ailleurs. Dans ce coin du 6ème arrondissement où le mètre carré dépasse les 13 000 euros, le calme n’est pas un hasard : c’est un privilège. Quand un quartier devient trop cher pour ses noctambules, il ne reste qu’une rue-dortoir. Et des habitants qui ont acheté le droit au silence.
Il n’est que 23 heures, mais la rue Vavin plie déjà ses auvents comme on ferme des paupières lourdes. Les terrasses se vident peu à peu, les verres s’empilent derrière les comptoirs, les rideaux métalliques crissent.
Une rue vivante qui, le jour, aligne ses vitrines bourgeoises, librairies d’art, cavistes, restaurants italiens aux nappes blanches, cafés qui sentent le croissant chaud, et qui, la nuit tombée, ressemble à une allée vide de province. Les rares passants avancent vite, le sac serré contre le ventre, comme si rien ne devait les retenir ici.
Le sol colle légèrement. La journée a laissé ses traces de cafés renversés, de mégots et de tickets de caisse coincés dans les caniveaux. Les rares lampadaires projettent une lumière jaunâtre qui accentue le contraste entre les façades Haussmann et les rideaux métalliques.
« C’est pas pigalle ici »
Un serveur au bistrot « Quartier Vavin ». 37 ans, chemise encore tachée de vin rouge, il fume sa dernière cigarette de service, dos contre le mur, regard tourné vers la fontaine Wallace. « À cette heure-là, dit-il, y’a juste des voisins qui râlent si tu parles trop fort, et deux-trois noctambules qui cherchent un kebab. Mais nous, on ferme tôt, c’est pas Pigalle ici. » Il hausse les épaules et l’écrase sous sa semelle.
Derrière lui, une salle vide où traînent encore des verres à moitié pleins. Après minuit, personne ne consomme vraiment. Les gens qui ont les moyens de vivre ici ont autre chose à faire que traîner dans la rue. Le portrait social du 6e arrondissement, dressé par la direction des solidarités, le confirme : pour un seul employé ou ouvrier, on compte 3,3 cadres, le ratio le plus élevé de Paris.
Avec seulement 2% de logements sociaux contre 18% à Paris, le 6e est une enclave pour privilégiés. Les résidences secondaires représentent près d’un quart du parc immobilier, la plus forte proportion de la capitale avec les 7e et 8e arrondissements. Quand un appartement sur quatre reste vide une partie de l’année, difficile de maintenir une vie de quartier.
La supérette de nuit, elle, s’anime. Derrière son comptoir, le gérant aligne packs de bières et bouteilles de vodka. Ici, le chiffre se fait après 22h. Une file se forme, des étudiants surtout, venus chercher de quoi prolonger la soirée ailleurs. « Je ferme à trois heures », explique-t-il, peu loquace, en scannant une bouteille de rhum. Ses clients ne sont pas du quartier. Ils viennent de la Cité U, de Denfert, des résidences étudiantes périphériques. Dans la rue, les propriétaires achètent leur vin en cave, pas chez lui.
Le prix du silence
Un deux-pièces dans la rue se négocie à plus de 13 000 euros le mètre carré, selon la chambre des notaires de Paris. Dans les immeubles haussmanniens, derrière les portes cochères et les digicodes à six chiffres, vivent des cadres supérieurs, des retraités aisés, quelques héritiers. Des gens qui peuvent s’offrir le luxe du calme en plein Paris. Pas de kebabs ouverts jusqu’à l’aube, pas de bars étudiants qui vomissent leur clientèle à trois heures du matin. La tranquillité a un prix, et ils l’ont payé.
Le revenu annuel médian atteint 39 330 euros dans le 6e arrondissement, soit près de 12 000 euros de plus que la moyenne parisienne. Ici, 56% des actifs occupent des postes de cadres ou exercent des professions intellectuelles supérieures, dix points de plus que dans le reste de la capitale.
À 23h30, un peu plus bas, devant le O’Tacos fermé depuis 23h, un livreur Deliveroo se cale contre son vélo, casque sur l’oreille, scotché à son écran. Il attend une commande qui ne viendra pas. « Les restos sont tous fermés », lâche-t-il dans un souffle, comme s’il n’y croyait pas lui-même. Dans quelques minutes, il glissera vers la rue Notre-Dame-des-Champs, aspiré par un autre quartier plus vivant, là où les étudiants commandent encore des burgers à deux heures du matin.
À mesure que l’heure avance, le silence se fait pesant. Pas de cris, pas de sirènes. Juste le roulement régulier d’un bus sur le boulevard Raspail, au coin. Dans ce calme, on distingue les bruits insignifiants. Un volet qui claque, un sac plastique soulevé par le vent, une clé dans une serrure.
Une résidente âgée, chignon gris serré, descend ses poubelles. Elle parle à voix basse, comme si le trottoir pouvait répercuter ses secrets. « Vous savez, cette rue n’a jamais été bruyante. Même dans les années 70, avec les cinémas et les bars, ça restait tranquille. Maintenant, c’est presque trop calme. On se sent seuls, parfois. » Elle marque une pause. « Avant, il y avait des enfants dans la cour. » Elle habite ici depuis 1978, a vu les loyers exploser, les familles partir. En 1995, le mètre carré se négociait autour de 3 860 euros, d’après la chambre des notaires. Plus de trois fois moins qu’aujourd’hui.
Une rue-dortoir
La rue Vavin est devenue ce que les urbanistes appellent une « rue-dortoir ». Un lieu de résidence, pas de vie. Les commerces qui ferment tôt ne sont pas des victimes de la crise : ils sont le symptôme d’une transformation sociale. Quand les loyers explosent, les locataires qui font vivre la nuit – étudiants, artistes, travailleurs précaires – sont chassés vers les banlieues ou les arrondissements périphériques. Restent les propriétaires, les cadres, les retraités. Des gens qui vivent le jour et exigent le silence la nuit.
La rue Vavin, la nuit, c’est un théâtre sans acteurs. Les enseignes éteintes deviennent des décors vides : la boutique de vins « Nicolas », façade rouge qui peine à déteindre avec la nuit, la librairie indépendante, ses rayonnages encore visibles derrière la vitre. Des commerces qui existent pour des clients de jour, qui ont les moyens de payer 35 euros une bouteille de Bourgogne ou 25 euros un livre d’art.
À 23h45, les pas se raréfient encore. Les taxis ne s’arrêtent plus. Le quartier semble reculer dans une sorte d’intemporalité. Une rue qui n’existe que pour le lendemain, figée dans son sommeil bourgeois. Dans les immeubles, derrière les volets tirés, rien ne bouge. Même les façades semblent dormir, fenêtres closes, rideaux tirés. Quelques rectangles lumineux subsistent. Peut-être un cadre qui finit un dossier, un retraité insomniaque qui regarde les infos en boucle.
Vavin ne fait pas de bruit en s’endormant. Pas de fêtards qui chantent, pas de musique qui déborde. Elle se couche comme on se retire poliment d’une conversation. Les vitrines s’éteignent une à une, les terrasses se vident, les clés tournent dans les serrures. C’est un silence qui n’est pas celui de la fatigue, mais celui de la sélection sociale.
À minuit, il ne reste qu’un trottoir désert, une supérette éclairée comme une veilleuse et une rue prête à renaître au petit matin, avec ses croissants à 1,50 euro et ses clients pressés en costumes gris. Mais à cette heure, Vavin n’est plus qu’un couloir silencieux, bordé de façades closes. Une rue qui se couche tôt parce qu’elle peut se le permettre.